Les oreilles de Mickey flottent sur le Parthénon!
Attention, travaux ! Architectures de bande dessinée - exposition à l'IFA, 6 rue de Tournon, 75006 Paris (article de 1985, publié dans Diagonal, n°55, pp.28-30, Paris)
les illustrations sont tirées du catalogue de
l'exposition "Architectures de bande dessinée" édité par l'IFA, diffusé
par IFA et Distique. Prix 150 francs.
"Putain ! quel est l'enfant de salaud d'architecte qui a construit cet étron !"
On se précipite rue de Tournon, vaguement inquiet quant aux
conséquences de cette iconoclastie car manifestement la BD a pris le
pouvoir sur l'Architecture, qu'en aura-t-elle laissé, telle qu'on la
connaît ? Le dessin de l'architecte tend à évacuer la figuration des
événements interhumains pour privilégier celle de l'avènement plastique
du projet. La stratégie iconique de l'architecte y conduit directement,
car le projet doit se présenter support de rêve pour tous : il ne faut
donc pas en montrer des appropriations trop précises, mais des usages
généraux et anonymes. On craint donc, en route pour l'IFA, de voir
succomber cet anonymat accueillant aux fantasmes de tout un chacun par
le récit, versatile, oh combien, de la BD moderne venant marquer des
espaces dont certains nous sont proches du sceau de ses incongruités.
Plus exactement du sceau de l'autre, toujours incongru par définition.
On voit mal quel architecte ayant terminé un rendu pour un concours y
mettrait en action des personnages dont les bulles confient, par
exemple : "pas mayen de trouver une entrée......, ou bien "rien ne
bouge là-dedans, capitaine" (Bob de Moor, Fortifications). La BD, en
donnant une seule action parmi l'infinité possible, détruit celle-ci
comme potentialité.
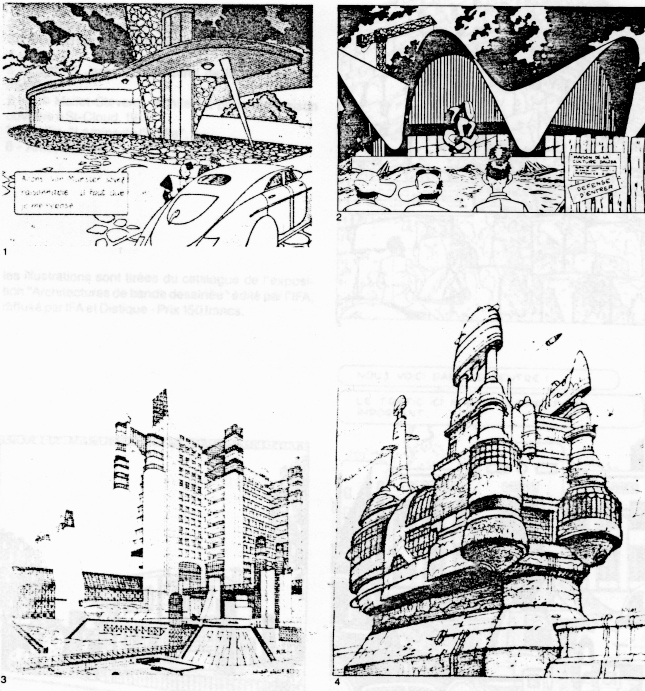
Des architectures "passeuses-à-l'acte"
Du moins le pensais-je avant. Ayant vu, ce n'est plus aussi certain. Il
y a, d'abord, l'effet roboratif de l'humour, et celui du courage des
organisateurs : la première bulle que j'ai lu hurlait : "Putain ! Quel
est l'enfant de salaud d'architecte qui a construit cet étron !". Voilà
qui fait plaisir, l'IFA prend des risques et ne prend pas les
architectes pour les fragiles plantes rares narcissiques qu'ils donnent
parfois l'image d'être. C'est dans la BD de Rochette : des loubards
indignés par l'édification d'une "Maison de la Culture Dalida" qui
dépare leur beau terrain vague, la dynamitent et héritent ainsi d'un
trésor de décombres auxquelles ils pourront donner sens euxmèmes. Une
vraie Love-Story d'architecture très bien soutenue en arrière-plan par
les ondoyantes dalidéennes de la MJC, que Rochette a dû piquer du côté
de Royan ou Caracas : du sous-Nervi des années 50. II y a une
demi-douzaine d'autres histoires (trés différentes !) ayant en commun
une interaction réelle entre architecture et sulet du récit. Dans
"Opéra-Boum" de Varenne, les statues du Palais Garnier partent au bal,
nues et en métro ! C'est donc une partie du monument qui s'anime et
vient parmi nous, comblant temporairement le hiatus entre la pérennité
architecturale et le fourmillement desvécus humains que les statues
semblent nous envier : elles échangeraient bien leur idéalité
sculpturale contre un peu de vie, même apparemment inepte dans son
individualité intransmissible. Très fort, bis !
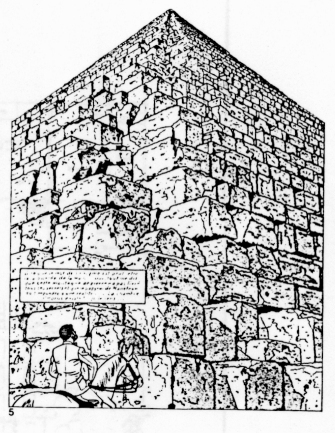
Dans le même registre des architectures "passeuses-à-l'acte" il y a
l'histoire de Comés sans aucun personnage humain, sinon le lecteur,
séduit par les sussurrements érotiques que fait entendre une maison
vide et privée d'amour, dont les replis Intimes se révèlent mortels
(mais trop tard, on a été eu). Ce sont quelques histoires fortes où
architecture et êtres vivants agissent à armes égales. Dans l'ensemble,
il n'y a cependant qu'une coexistence polie entre ces deux partenaires
: chacun laisse vivre l'autre moyennant le respect de quelques règles.
C'est d'ailleurs le mérite principal de cette exposition de montrer
enfin de la vie dans l'architecture, donc de l'imprévisible sans
relation avec le cadre architectural, sinon à un hypothétique Nième
degré. Le vide humain que nécessite le dessin d'architecture rappelle
le voyage dans le temps de la nouvelle de H.G. Wells : si les siècles
durent des secondes, on ne voit plus que les pierres, on voit même
l'évolution de l'urbain comme naturalisée, comme ces plantes prises en
accélère qui naissent, se dèplient, fleurissent, se décatissent et
meurent sous nos yeux.
L'invariant maternel !
Ce vide auquel tend la banalisation des particularités humaines est ici
violemment comblé : ça déborde de partout, et pourtant l'architecture
fait avec, elle parait même parfois protéger ou permettre des actions
contredisant son propre message. De rigoureux dessins de cadres
historiques grandioses viennent à point pour conférer une majesté à des
événements qui, tout imaginaires qu'ils soient, en retirent un cachet
d'authenticité assez impressionnant : il faut bien croire que c'était
vrai, puisqu'on vous montre exactement l'endroit où ! Inversement, les
fictions architecturales des dessinateurs SF
paraissent pauvres comparées aux délires de vrais architectes; sans
doute parce que chez ces seuls derniers, la faisabilité technique
réelle vient singulièrement pimenter l'utopie. L'appréhension premiére,
celle d'une submersion des espaces architecturés par le n'importe-quoi
tous azimuts des avatars existentiels, cède le pas au sentiment
libérateur d'avoir soi-même aussi le droit, comme tous ces inconnus
souvent étranges, d'exister en toute singularité, en toute indépendance
d'être par rapport aux directives qui semblent émaner des
architectures. Je crois, du coup, comprendre ce qui m'a frappé comme
exact dans le petit dessin provoquant de Joost Swart quand il a collé
des oreilles de Mickey à un temple Dorique. C'est la protection
symbolique qu'offrent les oreilles de Mickey dont l'exposition ne
retient aucune BD par ailleurs. Ces oreilles, devenues ici symboliques
de la BD elle-même ne le sont pas par hasard. Elles ont fait le succès
de Mickey auprès de trois ou quatre générations de gosses de tous les
pays et cela ne s'improvise pas : lorsque l'on regarde Mickey s'agiter
dans ses aventures, ces deux oreilles ne sont jamais vues de côté,
toujours fidèles au poste, toujours rondes, toujours deux et de face.
Quoi qu'il advienne elles rassurent. Sous la haute protection de cet
invariant maternel, l'enfant peut affronter, lui aussi, le
n'importe-quoi. Et n'est-ce pas ce que le cadre architecturai offre
lui-même aux personnages des récits réels que nous vivons, nous, chaque
jour ? Il y a donc un chassé-croisé amusant entre la protection
symbolique des identités individuelles permises par l'inaltérabilité
des cadres architecturaux et l'humour de sa symbolisation précisément
par cette partie anatomique de notre vieux copain d'enfance Mickey, qui
autrefois remplissait la même mission !
"Allons, Von Munster, soyez raisonnable... íl faut que je me repose".
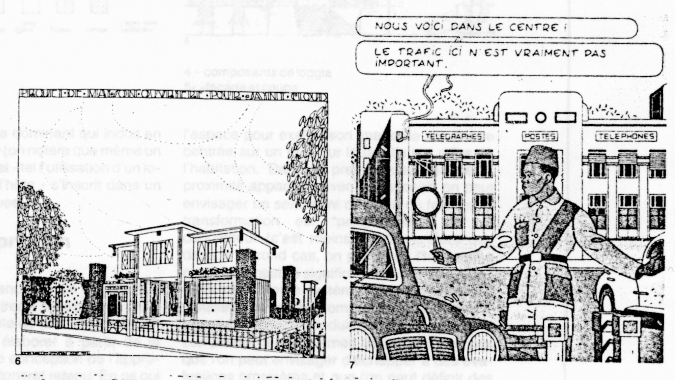

1 - Jean-Louis Floc'h, "En pleine guerre froide".
2 - Rochette, "Terrains vagues"
3 - Antonio Sant'Elia, architecte, ville futuriste, 1914.
4 - Bilal
5 - Edgar P. Jacobs, "Le secret de la grande pyramide"
6 - Bob Mallet-Stevens, architecte, projet de maison ouvrière à St-Cloud,1914.
7 - Goffin, "La mine de l'étoile .
8 - Arno, "Bunker".